L'église Saint Jean Evangéliste à Ravenne
Les mosaïques de cette église sont particulières par rapport aux autres
églises décrites plus avant : il ne s’agit pas de mosaïques murales mais
de pavements de sol et elles sont beaucoup plus récentes, elles ne sont
pas paléochrétiennes mais datent du treizième siècle (1213), lorsque
l’abbé Guglielmo, supérieur du monastère en charge de l’église, a décidé
d’en refaire le pavement. Plus tard, par-dessus ces mosaïques on a
refait un nouveau sol couvrant les mosaïques et ce n’est qu’au milieu du
dix-huitième siècle qu’on les a retrouvées. Ce qui en restait a alors
été soigneusement récupéré, collé sur des panneaux qui ont été fixés aux
murs. C’est dans cette position que l’on peut encore aujourd’hui les
admirer. Elles
représentent les thèmes des romans courtois de l’époque,
des animaux fantastiques et des personnages de la quatrième croisade.
|
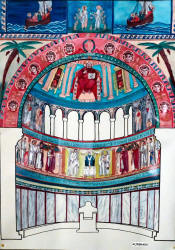
 |
En
1944, l'église fut sérieusement endommagée par les bombardements aériens
qui causèrent la perte des fresques du XIIème – XIVème siècle ainsi que la
destruction des mosaïques de l’abside.
Reconstitution
des parties perdues : les navire représentent l'épisode de la tempête dans
laquelle Galla Placidia fit le voeu de construire une église si St Jean L'Evangéliste
intervenait pour sa sauvegarde et celle de ses deux enfants (son
fils Placidus Valentinien et sa fille Justa Grata Honoria)
alors à bord. |
|
_small.JPG)

 |
Le tympan représente l'apparition de Saint Jean à Galla Placidia entre deux
groupes d’anges. L’impératrice Galla Placidia, coiffée de sa
couronnée, est allongée sur le sol. A gauche, St Jean l'Evangéliste tient un
livre en main, son évangile.
|
|
 |
Au-dessus du tympan, un autre bas-relief s’inscrit dans un triangle. Sous la
représentation du Rédempteur, l'empereur
Valentinien III, reconnaissable à sa couronne, ce fils de Galla Placidia
sauvé de la tempête. Assis près de lui, Saint Jean. À gauche, Barbazien
accompagné de prêtres. Barbazien était venu d’Antioche à Rome, où il menait
une vie de prière, de pénitence et accomplissait des miracles. Avant sa
fuite à Constantinople, Galla Placidia était pleine d’admiration et de
dévotion pour lui. Quand elle est revenue et décide la construction de
l’église, elle le fait venir à Ravenne où il fonde, lié à l’église, le
monastère de Saint-Jean l’Évangéliste. De l’autre côté, à droite, Galla Placidia, couronnée et suivie de soldats en armes. |
_small1.JPG)
_small1.JPG) |
Description de Raffaella Farioli Campanati
Cette scène
d’interprétation difficile est considérée dans son genre, soit comme un acte
d’investiture, soit comme la représentation d’un postulant reçu par le Pape,
mais elle fait l’objet aussi d’une exégèse plus complexe. A droite, un
personnage, un rouleau de parchemin dans la main gauche est en train de
s’adresser à un jeune homme, porteur de deux messages, agenouillé devant
lui. Il a été avancé une hypothèse élaborée selon laquelle cette scène
figurerait la rencontre entre le Pape Innocent III et le jeune Alexis Ange
(le futur empereur Alexis IV) fils de l’empereur détrôné, qui se serait
rendu auprès du Pape pour le prier de lui prêter secours et qui aurait
justifié le détournement de la Croisade sur Constantinople.
Jeune fille offrant une rose à son bien-aimé.
La nouvelle lecture de Nurith Kenaan-Kedar
La narration semble commencer par un évêque siégeant sur sa
Cathèdre (dentifié grâce à sa mitre) pendant qu’un homme de la noblesse vêtu
d’une robe courte et d’un manteau lui remet ou bien reçoit de lui un rouleau
de parchemin, ce qui est synonyme d’ordre de mission.
La scène du chevalier ou du noble faisant ses adieux à sa
femme. Tous deux sont debout devant leur château. L’homme placé à sa droite
lui fait au revoir de la main et celle-ci tient une fleur à la main en signe
d’amour fidèle |
|
_small1.JPG)
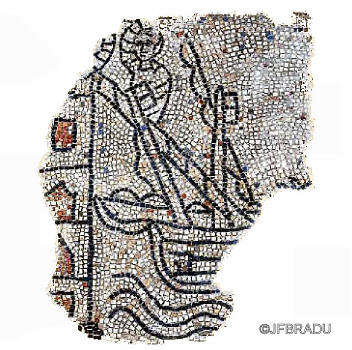 |
Description de
Raffaella
Farioli Campanati
Hissé avec peine sur le mât du navire qui manoeuvre, une
seule voile déployée, le marin signale sa présence, les joues gonflées en
soufflant avec force dans une corne.
Il est difficile de savoir s’il s’agit de la 1 ère
tentative pour se rendre maître d’une partie de la
muraille ou plutôt de la seconde prise de Constantinople en avril 1204 dont
le procédé tacticien sera de débarquer directement des navires aux remparts
au moyen d’échelles de corde.
La nouvelle lecture de
Nurith Kenaan-Kedar
Au moins deux fragments peuvent
sûrement être regroupés lesquels représentent des navires qui voyagent en
mer, le premier desquels montre un homme sonnant la corne
La traversée du retour. L’homme de veille est debout à la
tête de mât et scrute l’horizon. Cette représentation peut être combinée à
celle du fragment du bateau |
|
_small.JPG)
_small.JPG) |
Description de Raffaella Farioli Campanati
En
formation serrée, armés de lances, les soldats sont revêtus d’un long
haubert à mailles de fer en forme d’écaille, aux manches longues. Ils
tiennent des boucliers amygdaloïdes (en forme d’amande) ayant la partie
supérieure plate. Ces modèles sont très répandus à la fin du XIIème siècle.
A la place du heaume, les guerriers portent en couvre-chef, le camail,
partie intégrante du haubert. Cette protection est caractéristique des
armures islamiques utilisées dans les zones en contact avec le monde
oriental.
Comme on
peut le constater d’après la partie de bouclier derrière son dos, le Croisé
a au moins un soldat qui le suit - cette scène devait probablement être
constituée de façon analogue à celle de l'autre guerrier- Le soldat est
revêtu de l’armure habituelle des Croisés, un long haubert à mailles de fer
en forme d’écaille, un camail et des chausses à mailles de fer, un bouclier
en amande aplati en haut et décoré de bandes obliques.
La nouvelle lecture de
Nurith Kenaan-Kedar
Dans le premier registre, j’inclus les soldats partant pour
la guerre et un autre panneau montrant deux soldats au combat.
|
|
_small1.JPG) 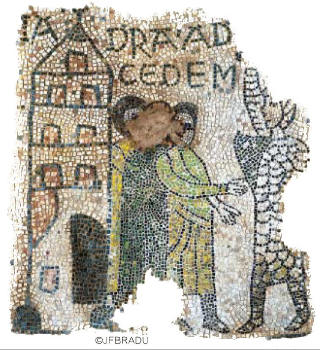 |
Description de
Raffaella Farioli Campanati
Episode de la IVème Croisade. La Prise de Constantinople
La légende explique l’événement. Près d’une tour qui devrait représenter les
murs de la cité, les vaincus avancent, tristes, en signe de soumission, vers
un guerrier croisé menaçant, qui brandit l’épée.
Le 15 novembre 1202, les Vénitiens ayant à leur tête le doge
Enrico Dandolo, lui-même, saccagent la Cité comme l’indique la didascalie
(note explicative) “ IADRA AD….CEDEM ” qui revient de nouveau à la
République de Venise. La composition est analogue à celle de la prise de
Constantinople.
La nouvelle lecture de Nurith Kenaan-Kedar
La bataille de Zara et la bataille de Constantinople
figurent les croisés qui capturent et tuent des prisonniers.
|
|
_small1.JPG)
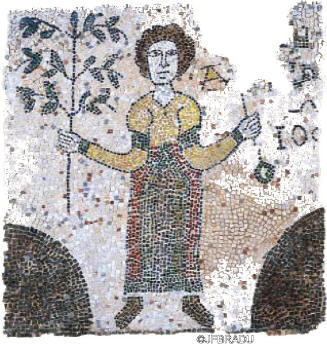 |
Description de
Raffaella Farioli Campanati
Jeune fille faisant don d’une rose à son bien-aimé.
Il est délicat de donner une interprétation de ce fragment,
une frise sans doute qui montre de face, une figure féminine au regard
étonné. Elle tient d’une main un rameau et de l’autre un objet rond suspendu
peut-être à unebranche. Les traces d’inscription ne sont pas suffisantes
pour définir le sujet représenté. Il pourrait s’agir sans doute d’un thème
biblique évoquant la légende d’Eve et de l’arbre de la connaissance qui
circulait au XII ème siècle et qui conte comment Eve en
voulant cueillir le fruit défendu détacha aussi la branche. Après avoir été
chassée du Paradis, et s’apercevant qu’elle tient encore la branche, Eve la
plante en terre. La branche s’enracine et devient un arbre blanc comme
neige. Sous cet arbre Caïn tue Abel. L’arbre prend alors la couleur rouge du
sang.
La nouvelle lecture de Nurith Kenaan-Kedar
La femme remettant une fleur à l’homme. Cette fois
elle se situe à gauche sur le panneau et lui à droite. Le récit commence de
son côté à elle. Ceci est l’histoire d’une Odyssée médiévale : un homme
parti en croisade et de retour chez lui sain et sauf.
La scène de la femme tenant la branche d’arbre – communément symbole de foi
et de vie éternelle. Elle semble être celle qui a commandé la mosaïque en
l’honneur de son mari. Cette hypothèse est aussi confirmée par la date de la
mosaïque: 1213. Si le chevalier était de retour en 1204-1205 pourquoi alors
la mosaïque avait-elle été offerte en 1213? Il est plus probable que le
pavement fut donné par sa femme après sa mort en sa mémoire. Par conséquent,
la scène de l’arbre déraciné pourrait suggérer cet événement. |
|
_small.JPG)
La
vache
Dans un identique encadrement se détache, de profil, une
vache au pelage de deux couleurs. Elle se dirige lentement vers la gauche.
|

Le cerf
Ce quadrupède est également représenté de profil, tourné
vers la gauche, la tête légèrement baissée; peut-être se prépare-t-il à
brouter ou boire. Le caractère paisible de l’animal que le Physiologus
cite en se référant au Psaume 41.2 (Sicut cervus desiderat ad fontes
acquarum ita anima mea ad Te, Deus) est clairement visible. Animal
providentiel, positif vainqueur du diabolique serpent. |
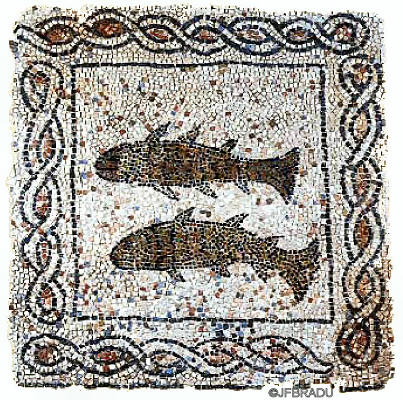
Deux poissons
Des poissons disposés parallèlement et horizontalement se
dirigent vers la gauche. Celui du haut a une apparence plus raide que son
suivant. L’encadrement répète les détails vus auparavant.
|
|
_small.JPG)
La
licorne
Tournée vers la droite, la licorne, de profil, se détache du
panneau, à l’intérieur d’un cadre végétal à sarments de vigne sinueux et à
coeurs qui se répètent. Le Physiologus la décrit comme un quadrupède
semblable à un chevreau mais doté d’une unique corne sur le front et d’une
force extraordinaire, si bien que les chasseurs ne réussissent pas à la
capturer. Elle s’approche seule d’une vierge qui l’accueille contre son sein
et la porte au Palais du roi. La licorne est le symbole du Christ, la
Vierge, le symbole de Marie. Une représentation en partie détruite, où
figure la Vierge en compagnie d’une licorne, apparaît entre autres à
Piacenza (crypte de St. Savino) à Cremona, à St. Benedetto Po et sur une
partie de la mosaïque dans la cathédrale de Pesaro; l’inscription suivante
la complète: “Pulcrapuella venit et mulcet comu unicornu”. |

Fragment décoratif
A l’intérieur d’une bordure libre, à sarments de vigne
sinueux se détachent des fleurons stylisés à huit éléments nuancés en
fonction des zones chromatiques dans les éléments les constituant. Ce
fragment est défini par huit côtés concaves reliés par des motifs liliaux
qui rappellent les éléments à palmettes déjà répertoriés dans la mosaïque
ravennate.
|
_small.JPG)
Fleur
Ce fragment entouré comme le précédent présente une
décoration géométrique formée de huit secteurs circulaires mis en valeur par
des couleurs contrastées.
|
|
_small1.JPG)
La
panthère
Ce panneau représente la panthère tachetée, de profil
également et se dirigeant d’une allure majestueuse vers la gauche. Il est
entouré d’une bordure déjà observée et sur laquelle les sarments de vigne à
petites feuilles s’opposent aux coeurs qui se répètent. La panthère est
considérée aussi d’après le Physiologus comme une bête paisible,
symbole du Christ, elle attire les animaux par l’odeur qui émane d’elle et
elle a comme unique ennemi le maléfique dragon qui, à la vue de la panthère
rentre dans son antre.
PS : il semblerait que
Nurith Kenaan-Kedar voie
en cette panthère un tigre qui est un animal maléfique |
_small1.JPG)
Le
griffon
Un pourtour analogue à la précédente mosaïque, encadre le
griffon de profil. Cet animal fabuleux en Orient a un bec et des ailes
d’aigle et un corps de lion; en Grèce animal de la lumière, il est consacré
à Apollon et participe à la déification d’Alexandre. De par sa double nature
il est souverain du ciel et de la terre, emblème de la double royauté du
Christ (Dante, Purgatoire XXXII). L’iconographie du griffon le montre, isolé
ou avec une proie entre ses griffes sur les étoffes d’art, ce que montrent
fréquemment les tapisseries et les mosaïques médiévales en Italie et de
l’autre côté des Alpes. On retiendra en particulier les représentations du
griffon à St. Ilario de Fusina, St. Marc à Venise, à Murano, à Pomposa, dans
le dôme d’Aosta, à St. Benedetto Po Pieve Terzagni, à Brindisi, Otrante, à
St. Maria del Partir à Rossano. |
_small1.JPG)
Une
harpie
Cette créature volante au profil de femme laide, coiffée
d’un chapeau conique a des pattes de quadrupède; oiseau nocturne entre le
vampire et la sorcière, avide de sang humain et terreur des petits enfants,
elle peut être comparée à ces deux monstres analogues qui figurent sur une
mosaïque médiévale de la cathédrale de Pesaro, marquée de ce mot LAMIE. Pour
cette raison nous pouvons l’appeler Lamia. Dans le cas présent, cet être
monstrueux représenté avec une queue de poisson, pourrait également faire
penser à une harpie.
|
|
_small.JPG)
Les funérailles du renard qui feint d’être mort
Entouré de motifs végétaux opposés deux à deux, sarments
de vigne sinueux à petites feuilles et coeurs qui se répètent, ce panneau
représente la scène des funérailles du renard, pattes liées et pesant de
tout son poids sur un bâton droit porté par deux jeunes coqs face à face. Ce
thème (qui existe aussi en sculpture) a des précédents à Venise, Basilique
St. Marie, à Murano dans l’église SS. Maria et Donato (1140), à Vercelli sur
la mosaïque disparue de SS. Maria Maggiore (1150) et puis dans la cathédrale
d’Otrante. Le récit ravennate est comparable en ce qui concerne
l’organisation le composant aux mosaïques vénitiennes antérieures au célèbre
roman de Renart connu au XIIème siècle où, comme il a été observé, la
représentation des funérailles beaucoup plus complexe met en scène des
animaux différents (deux cerfs portent le renard). Dans ce cas également il
est difficile de préciser de quelle source littéraire elle s’est inspirée. |
_small.JPG)
L’oie à l’encensoir
Le panneau encadré, comme le précédent fait partie selon
toutes probabilités des funérailles du renard auxquelles fait suite un
cortège d’animaux : ici, au second plan, un canard, en premier, l’oie avance
d’un pas incertain, l’encensoir suspendu à son bec. Dans le roman de Renart
c’est par contre, comme dans les mosaïques de Vercelli, le coq Chanteclerc
qui, l’encensoir suspendu à son bec, suit le cercueil.
|
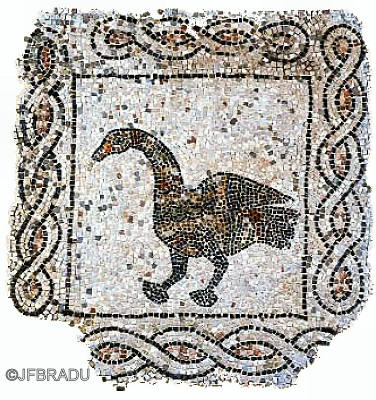
L'oie
Ce bipède est aussi représenté de profil et en mouvement,
dans un cadre défini comme dans le panneau précédent et dans ceux qui vont
suivre, par un rang de tesselles sombres formant tresses sur le pourtour.
|
|

Le Chien ou le Loup
A l’intérieur du cadre entouré d’une tresse à double filet,
la figure d’un quadrupède, de profil, s’élance vers la gauche d’un mouvement
vif.
|
_small1.JPG)
La sirène
D’après l’iconographie médiévale, la sirène est
représentée ici par une femme-poisson à deux queues dont elle tient une
extrémité caudale dans chaque main. Sur les sols de mosaïques de l’Italie,
au XII et XIIIème siècle, la sirène est représentée de cette façon à Pieve
Terzagni, Piacenza, à St. Savino, dans les cathédrales de Reggio- Emilia,
Pesaro et d’Otrante, et elle sert de modèle pour de nombreuses sculptures.
Cette créature à deux corps a une double signification positive ou négative
comme l’indique le Physiologus qui la décrit d’après l’iconographie
antique comme la femme-oiseau qui ensorcelle ou dévore les marins. |
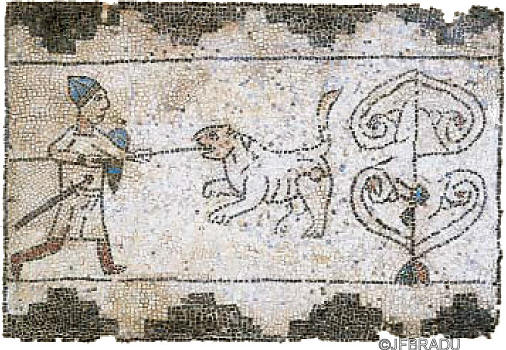
Guerrier blessant une bête fauve
Cette scène fait suite, sur la droite à celle décrite
ci-dessus après une coupure à caractère décoratif. C’est un guerrier protégé
d’un heaume et d’un bouclier en forme d’amande. Il actionne sa lance qu’il
jette sur une bête féroce. Dans ce cas aussi, la manière graphique de
caractériser le personnage s’apparente rigoureusement à celle utilisée dans
la IVème Croisade, toutefois elle s’en éloigne de par l’habillement de type
oriental qui rappelle les représentations de chevaliers sur les soieries
byzantines. Ce sujet, outre le fait qu’il dépende d’une iconographie plus
précise, est renvoyé à un thème dont il serait difficile de déterminer la
référence narrative |
|
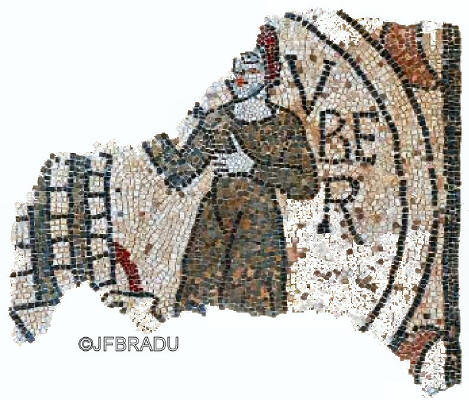
Le mois d’Octobre
L’illustration d’Octobre, unique et presque entièrement
intacte, sur laquelle est présenté un élément fragmentaire marron
appartenant à une cuve ou un tonneau (aussi appelé douves), est en rapport
avec les travaux de cette saison: le vin soutiré se déverse en jet dans une
sorte de broc dont on ne voit que le bord de l’embouchure. On suppose, comme
on peut le déduire d’après la position du bras levé sans main, qu’Octobre
tient dans celle-ci un verre pour déguster le vin. Les Mois montrent leurs
activités respectives, évocatrices du temps humain inscrit dans le renouveau
cyclique de l’Année sacrée et de la dignité du travail comme moyen de salut;
le Labyrinthe à la signification purificatrice se réfère symboliquement à la
vie de l’homme, à sa lutte menée pour dépasser le péché. Mois et Labyrinthe
sont deux thèmes bien caractéristiques de l’iconographie médiévale et sont
également répandus par l’intermédiaire de la riche expression
symbolico-décorative trouvée sur les pavements de mosaïque du XIIème siècle
dans la Val Padana. |
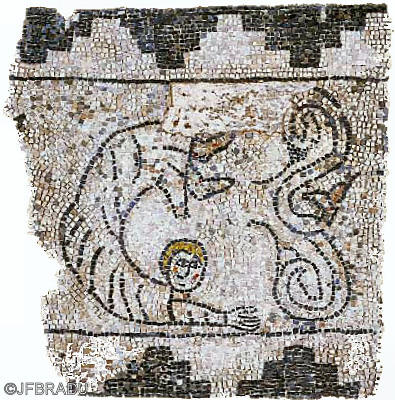
Personnage dans un mouvement de chute ou de plongée
Le personnage appartient à la deuxième bande du pavement,
bordée de gros triangles en dents de scie, et située au commencement de la
nef. Il est difficile d’interpréter cette étrange figure qui devait
appartenir à un ensemble non conservé. Le style graphique de ce genre à des
similitudes avec les personnages dans la série des croisades.
|

Fragment décoratif à lignes brisées
Il appartient à la large bande parcourue d’un motif, en
zigzag blanc, rouge et noir, bordé d’une série de grosses dents de loup
blanches et noires. Le thème à lignes brisées se rencontre fréquemment sur
les mosaïques de Val Padana, dans la crypte de St. Savino, à Piacenza et sur
les mosaïques médiévales de la cathédrale de Turin; il signifie l’eau. A
Pavia, à St. Maria Vétere (de nos jours au Musée) il y avait une semblable
décoration.
|


