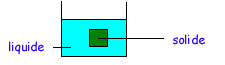|
L’histoire
des sciences est jalonnée de découvertes essentielles qui ont modifié le
savoir des hommes, leur vision du monde, ou tout simplement leur vie
quotidienne. A chacune de ces découvertes est lié un personnage auquel ses
admirateurs, la rumeur populaire ont associé une phrase, une fable transformant
le découvreur en héros mythique. La mémoire collective perpétue ainsi les légendes
édifiantes de Newton et de sa pomme, de Galilée et de « et pourtant
elle tourne », de Pasteur et du petit Joseph Meister; on assiste plus près
de nous à la transformation en héros scientifiques de Marie Curie dans son
laboratoire miteux et d’Albert Einstein immortalisé autant par son poster que
par sa formule (dont le sens est plus que relatif pour beaucoup) .
Un des premiers
savants légendaires est sans doute
Archimède
indissociable de sa baignoire et
d’euréka. Son appartenance à la
Grande Grèce
a sans doute favorisé sa
semi-déification et contribué à l’élaboration de sa légende. Ses
admirateurs parmi lesquels Cicéron qui découvrit sa tombe, Plutarque, Vinci, et
plus tard Auguste Comte ont perpétué, enrichi les contes et légendes
d’Archimède.
Les certitudes
concernant sa vie
Archimède a vécu
à Syracuse, opulente cité de Sicile qui faisait partie de la grande Grèce.
C’était un
ami du roi Hiéron.
Il est mort âgé
de 75 ans au cours du siège de Syracuse sous les coups d’un soldat romain.
C’était un savant semblable à ceux qui ont pu exister jusqu’au XVIIIème
siècle, c’est dire à la fois physicien, mathématicien, ingénieur et
philosophe.
Il a écrit
plusieurs ouvrages, douze nous sont parvenus, on suppose que trois ou quatre ont
été perdus.
Les
suppositions.
On ignore tout
ce qui concerne sa vie personnelle, même la date de sa naissance (qu’on peut
cependant calculer par différence); en effet, sa biographie, attribuée à Héraclite,
a disparu.
Tous les
« portraits » le représentant sous les traits d’un vieillard
barbu ou sous ceux d’un homme plus jeune courant dans les rues dans le plus
simple appareil datent au mieux du XVème siècle.
Il est possible
qu’il ait effectué un voyage à Alexandrie, ville grecque d’Egypte,
capitale intellectuelle, siège d’une immense bibliothèque. Sinon il a pu
avoir une correspondance avec des savants résidant dans cette ville (Euclide
fut sans doute un de ses maîtres)
Les
circonstances exactes de sa mort restent assez floues, Plutarque en donne trois
versions plus ou moins édifiantes.
Les recherches
et les découvertes d’Archimède en mathématiques et en physique ont été à
l’origine d’autres études, et
quelques unes sont au programme de nos lycées et collèges comme par exemple la
mesure du volume par déplacement d’eau qui correspond au plus célèbre conte
concernant Archimède.
De la légende
à la physique du collège
L’hydrostatique
La couronne, le
roi et le faussaire.
Un beau jour,
le roi commanda une couronne en or pour l’offrir aux Dieux, il donna à
l’orfèvre la masse d’or nécessaire à la fabrication. La couronne réalisée
était superbe, elle fut pesée, sa masse était identique à celle de l’or
donné.

Pourtant le roi
avait un doute la couronne ne semblait pas faite d’or pur, il demanda à son
ami Archimède de s’en assurer mais sans détruire l’ouvrage donc sans le
fondre ni le scier.
Archimède
chercha, chercha mais la notion de volume et à qui plus est la mesure du volume
d’un solide de forme complexe ne faisait pas partie des connaissances
scientifiques de l’époque.
Comme ses
contemporains Archimède était amateur de bains, en se plongeant dans une
baignoire pleine il constata que celle-ci débordait et... Eurê Eurêka!, il
avait trouvé, le problème était résolu, il sauta hors de son bain, courut
tout nu dans les rues pour annoncer sa découverte, il allait pouvoir mesurer
le volume de la couronne et celui de l’or donné par déplacement
d’eau.

La couronne
avait un volume supérieur à celui de l’or donné, elle contenait donc un
autre métal en l’occurrence de l’argent, qui pour un même volume pèse
moins lourd que l’or.
La notion de
masse volumique entrait dans l’histoire.
On dit
maintenant que 1 cm3 d’or pèse 19,3g et que 1 cm3
d’argent pèse 10,5g
Le roi s’était
bel et bien fait avoir, l’orfèvre avait gardé une partie de l’or mais
l’histoire ne dit pas ce qui advint de lui.
Le principe
d’Archimède
Le fameux
principe devenu loi ou théorème a en fait été démontré au XVIème siècle.
Son énoncé figure dans un des ouvrages d’Archimède: « Le Traité des
corps flottants »
Proposition III
:
Un solide de même volume et de même poids
(en
fait de même masse volumique) que le
liquide dans lequel il est abandonné y enfoncera de façon à n’émerger
nullement au-dessus de la surface, mais à ne pas descendre plus bas.
Proposition IV
:
Tout corps plus léger que le liquide où il est
abandonné ne sera pas complètement immergé, mais restera en partie au-dessus
de la surface du liquide.
Proposition V :
Un solide plus léger que le liquide dans lequel on
l’abandonne y enfonce de telle façon qu’un volume de liquide égal à la
partie immergée ait le même poids que le solide entier.
Proposition VI :
Lorsqu’un corps est plus léger que le liquide où
on l’enfonce et remonte à la surface,
la force qui pousse
en haut ce corps a pour mesure
la quantité dont le poids d’un égal volume de liquide surpasse le
poids même du corps.
Proposition VII :
Un corps plus lourd que le liquide où on
l’abandonne descendra au fond et son poids, dans le liquide, diminuera
d’une quantité mesurée, par ce que pèse un volume de liquide égal
à celui du corps.
Soit en schémas :
Proposition III
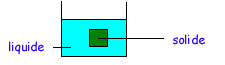
Masse
volumique du solide = masse volumique du liquide
Le
solide reste au sein du liquide où on l’a mis
Proposition IV :

Masse
volumique du solide
<
masse volumique du liquide
Le
solide flotte sur le liquide
Proposition V
:
:

Proposition VI
:

F1>P
Le corps remonte
|
Le
volume immergé devient de plus en plus petit F1 diminue |
F1=P
| |