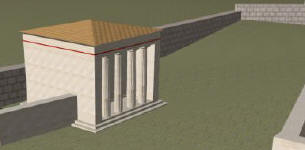|
Principaux événements historiques de l'Acropole
447 –
438 av. J.-C. : construction du Parthénon (décoration du temple avec des
sculptures en 432 av. J.-C..)
437 – 432 av. J.-C. : construction des Propylées
421 – 406 av. J.-C. : construction de l’Erechthéion
420 av. J.-C. : construction du temple d’Athéna Niké
267 ap. J.-C. : destruction de la partie intérieure du Parthénon par un incendie
361 – 363 ap. J.-C. : réparation du Parthénon (par l’empereur Julien?)
435 :
les Byzantins
n'appliquent pas l'Edit de Théodose prescrivant la démolition des temples
païens mais convertissent ceux-ci en églises et les pillent au profit de
Constantinople.
VI° siècle : transformation du Parthénon et de l’Erechthéion en
églises chrétiennes (l'entrée du Parthénon est reportée à l'ouest, la cella est
percée de quatre portes)
1204 :
après
la chute de l'empire Byzantin, Athènes est attribuée à des seigneurs francs peu
respectueux de ses ruines : de 1225 à 1308, les seigneurs de la Roche campent
dans les Propylées transformés en château, et l'archevêque latin officie dans
le Parthénon devenu Notre-Dame d'Athènes
1456 : prise d'Athènes par les Turcs Ottomans: le Parthénon est transformé en
mosquée (un minaret est construit dans l'angle sud-ouest)
tandis que
l'Erechthéion abrite épisodiquement le harem du gouverneur turc, les
Propylées sont utilisés comme poudrerie.
1640 : explosion des Propylées et destruction de la structure supérieure du
bâtiment central
1686 : démolition du temple d’Athéna Niké
1687 : explosion du Parthénon par les obus de Morosini.
Voir les détails
sur la responsabilité de Morosini

1801 : avec
l'autorisation officielle du Sultan, Lord Elgin, ambassadeur du roi d'Angleterre
auprès de la Sublime Porte, parachève le pillage en acquérant les marbres qui
font depuis 1815 l'orgueil du British Museum.
1835 :
un an après le rétablissement de la démocratie en Grèce, Constantin Caramanlis,
alors premier ministre, annonce la fondation d'un Comité pour la
Préservation des Monuments de l'Acropole. La première restauration concerne le
temple d’Athéna Niké par L. Ross
1839 – 1863 : première restauration de K. Pittaki (Erechthéion, Parthénon,
Propylées)
1835 – 1890 : fouilles sur l’Acropole jusqu'au substratum rocheux conduites par K. Pittaki, P. Kavadia, G.
Kawerau
1898 – 1939 : programme de restauration de N. Balanou sur tous les
monuments avec
l'utilisation d'agrafes de fer
:
le Parthénon
(1898-1902, 1922-1933), l'Erechthéion
(1902-1909),
les Propylées (1909 à 1917), le temple d'Athéna Niké (1935-1940).
1975 : interventions salvatrices et de restauration sous la surveillance du
Comité pour la Conservation des monuments de l’Acropole.
2000 : création d'un Service de Restauration de l'Acropole pour accélérer les
travaux afin qu'ils soient achevés pour les J.O. de 2004 (ce qui ne sera pas le
cas).
2005 : 230 personnes travaillent en permanence à la restauration.
2009 : la restauration se poursuit et ne sera achevée sans doute qu'en 2020 |
|
Quels sont les
buts
de la restauration actuelle?
- meilleure connaissance des
monuments et des techniques de construction
-
la
conservation structurelle
- la conservation des surfaces
- un degré maximal de protection des statues
- un repositionnement des blocs restaurés par le passé
- la restauration complémentaire de certaines plaques en utilisant,
principalement, des blocs tombés sur le site qui appartiennent au monument.
En quoi
consiste la restauration?
Dans
l’ordre suivant :
- démontage de parties de monuments* et enlèvement de blocs architecturaux.
*démonter toutes les anciennes réparations, éliminer le fer qui abîme les
marbres et le remplacer par un matériau inoxydable et stable, le titane.
- nettoyer les pierres et les renforcer contre la
pollution. Le nettoyage se fait au laser qui combine l'utilisation de rayons ultraviolets
et la lumière infra-rouge.
- enlèvement des sculptures (pour les abriter, le plus souvent, dans le nouveau
musée)
- reconstitution des blocs architecturaux en marbre en respectant le matériau
d’origine** et les techniques des Anciens
** Les
réparations primitives du début du XXe siècle conduisaient, pour l’assemblage
des blocs, à les retailler et à combler les vides avec du ciment. Maintenant, on
garde aux blocs leur forme originelle, et on comble les vides avec des matériaux
de même nature. Ainsi, on doit trouver du marbre ayant à peu près les mêmes
veines que celui des blocs originaux.
N. Toganidis, responsable du Parthénon, a
commandé un bloc de marbre pentélique de 12,5 tonnes, "sans trop de nervures",
pour remplacer la poutre en béton armé (architrave) placée au début du XX°s,
au-dessus de la grande porte du Parthénon (coût du bloc : 700 000 euros!)
-
remontage, correction des erreurs*** commises lors des précédentes
restaurations, ainsi que mise en place de reproductions fidèles des sculptures
retirées.
Les copies sont
effectuées en pierre artificielle, à base de ciment, de sable de quartz, de
pigments inorganiques, pour résister aux conditions extérieures.
Elles sont
réalisées en utilisant des dispositifs de pointage pour correspondre exactement
à la surface fragmentée de l'ancien bloc antique. Cela réduit la
détérioration de l'ancien bloc et garantit la réversibilité de l'opération
(la réversibilité est l'un des grands principes théoriques du projet)
*** On
essaie autant que possible de remettre les blocs à leur emplacement d’origine,
et parfois, il faut se livrer à une véritable enquête de détective. |
|
Les premiers
résultats de la restauration en cours
Les
équipes de restauration travaillent avec des machines parfois créées pour
l'occasion. Aujourd'hui encore, le transport des blocs de marbre jusqu'au haut de l'Acropole est
problématique. Des camions les amènent du Pentélique au pied de l'Acropole, côté
sud-est, de là ils subissent une première découpe puis sont hissés par une grue
spéciale montée sur rails, capable de lever de 50 m un poids de 10 tonnes.
Arrivé en haut de l'Acropole, les blocs sont placés sur un wagonnet et conduits
au chantier. Une machine est spécialement conçue pour ciseler les cannelures des
colonnes. Quand les tambours ont été empilés, les finitions se font à la main.
Utilisation de l'informatique : tous les blocs sont entrés dans une base de
données pour aider à retrouver leur place originelle.
Quels sont les
moyens
utilisé?
De
2001-2005, 1000 pièces (pour un poids total de 2,315 tonnes) ont été démembrées
et rassemblées, 1100 fragments ont été recollés et remis en place, 690 additions
ont comblé d'anciens fragments, 90 nouvelles sections de marbre ont été
ajoutées.
Nos connaissances sur les
techniques de construction et d'assemblage des Anciens ont été profondément
renouvelées. Les
blocs de marbre étaient grossièrement équarris dans les carrières du Pentélique,
transportés sur le chantier, et travaillés sur place. Mais certains blocs
(éléments d'architraves et de linteaux, tambours de colonnes...) pèsent jusqu'à
12 tonnes.
Le
nettoyage des sculptures de la frise ouest a révélé des traces de couleur : le
rouge, qui provient de l'hématite, le bleu égyptien ; l'utilisation de ces deux
couleurs était déjà connue, mais on a trouvé aussi des traces de vert, obtenu à
partir de malachite. Les textes antiques nous apprennent d'ailleurs que non
seulement les frises, mais aussi les colonnes étaient
peintes. L’examen
du sol de la maison des Arrhéphores a permis de découvrir des fragments
d’architecture et de sculpture du Parthénon, comme un élément d’une métope du
côté nord. |
|
Où en sommes-nous des
différentes restaurations ?
-
Les
Propylées :
autres
pages sur les Propylées
Parties restaurées : le portique Est, le mur Nord Est, l'anastylose de la salle
Ouest
Parties à restaurer : les
ailes Nord et Sud, la reconstruction du mur Sud de la salle Ouest
Les chapiteaux
ioniques d’origine, en mauvais état et très mal restaurés au début du XXe
siècle, ont été remplacés par des copies, les originaux seront placés dans le
nouveau musée.
Selon T. Tannoulas,
responsable des Propylées, le marbre neuf représentera un tiers des pièces
restaurées.

Pour ne pas confondre les parties originales et celles restaurées (blanches), on
joue sur la couleur. On voit bien ici, les deux chapiteaux ioniques blancs qui
sont des copies (photo 05-2009)

Les propylées sont en pleine
restauration - Cliquer pour agrandir (photo 05-2009)
- Le
Parthénon :(autres
pages sur le Parthénon :
voir ici
et
ici
)
Il est bien difficile de faire le point faute d'informations précises et
actualisées. La restauration (qui comprend 12 programmes) devait être terminée pour les JO de 2004, puis en
2006. A l'été 2009, je constate que c'est loin d'être terminé. Le retard est
sans doute dû au fait qu'il a fallu reprendre des parties déjà restaurées.
Ainsi, les 6 colonnes du pronaos mises en place en 2004 ont dû être démontées
puis remontées.
Explication : l'absence de cannelures les rendait inesthétiques et jurait avec
l'environnement ; on a donc décidé d'ajouter des cannelures, en dégrossissant
d'abord les tambours avec une scie électrique spécialement conçue à cet effet
(ce qui nécessite le désassemblage des tambours), les finitions se faisant à la
main ultérieurement. Il faudra un an pour traiter et remettre en place les 33
tambours concernés.
De plus, au fur et à mesure de la restauration, le programme est changé :
- il est décidé en 2006 d'enlever
7 des 8 métopes d'origine qui restaient encore sur la frise dorique le long du côté
nord,
il s'agit des métopes 24, 25, 27 à 31, qui sont remplacées par d'anciens
moulages, tandis que les originaux, après nettoyage et restauration, seront
exposés dans le nouveau musée de l'Acropole. L'opération a eu lieu durant
l'année 2007. Désormais, seules la métope 32 (à l'extrémité ouest du côté nord)
et les 14 métopes du côté ouest seront les éléments originaux de la décoration
sculptée encore en place sur le Parthénon. La frise Est a été transférée vers le
musée en 1993.
- Mais en avril 2008, le
directeur de l'Acropole d'Athènes, fait campagne pour que les dernières
sculptures antiques originales en place sur le temple du Parthénon soient
déménagées, elles aussi, avant d'être définitivement dégradées par la pollution.
"Il reste 17 métopes* de la frise dorique. Il faut les protéger car elles ne
supportent plus les conditions atmosphériques", affirme Alexandros Mantis, qui
réclame leur transfert dans le nouveau musée au pied de l'Acropole.
Mais l'opération, qui reviendrait à débarrasser le Parthénon de ses dernières
sculptures originales, n'a pas que des partisans.
"il n'y a pas eu de décision du KAS, il faut d'abord lancer les études
nécessaires et ensuite convoquer une conférence internationale pour décider", a
affirmé la responsable du service de restauration de l'Acropole (Ysma), Maria
Ioannidou.
Le directeur des restaurations des monuments antiques (Daam) du ministère de la
Culture, Démosthène Giraud, est tout aussi prudent: "il est nécessaire d'établir
des études détaillées", dit-il. Mais pour le directeur de l'Acropole il y a
urgence. "Nous devons à tout prix conserver notre patrimoine", insiste-t-il.
* 14 métopes sur la face
occidentale et deux autres sur la face nord dont l'une est connue sous le nom de
"l'Annonciation" : elle avait été laissée intacte par les premiers Chrétiens qui
avaient cru voir dans la scène une représentation de l'annonce faite à Marie.
Une dernière métope sur la façade sud représente une scène du combat entre Les
Centaures et les Lapithes. Elle est attribuée à Myron, le sculpteur du fameux
Discobole.
A l'origine, 92 métopes ornaient la frise dorique, l'ensemble sculpté le plus
ancien du Parthénon. Très peu sont restées en place et la plupart sont mutilées
et méconnaissables. Celles de la façade principale à l'est représentent le
combat des dieux et des géants, celles du sud, les combats des Lapithes et des
Centaures (voir ici), celles à l'ouest, le combat des Grecs contre les Amazones, et celles
au nord, des scènes de la guerre de Troie.
En définitive, la
nouvelle intervention est décidée pour la
façade
ouest,
qui a souffert successivement des attaques des chrétiens (sculptures abîmées),
de la guerre d'indépendance (700 impacts ont été repérés), des séismes de 1981
et 1999, et de l'humidité constante sur cette façade ; on prévoit la présence
d'échafaudages pendant trois ans à partir de 2009 ; les travaux comprendront la
dépose des métopes authentiques qui restent et leur remplacement par des
moulages, la consolidation du fronton, avec la remise en place de deux
fragments antiques et l'addition de nouveaux morceaux de marbre.
- en novembre 2009, la restauration des colonnes du côté nord est en cours et
s'achève.
Restera ensuite à enlever la dalle
temporaire qui protège actuellement le sol.
La question d’une toiture a également été posée.
Les spécialistes ont retrouvé
pas moins de 1600 morceaux du Parthénon, disséminés autour de la colline. Quand
ils seront remis en place, l'édifice aura retrouvé 15% en plus de sa structure
avant restauration.
 
côté ouest : les moulages de
la frise des Panathénées sont prêts à être mis en place
 |
 |
|
côté ouest : on distingue
bien les 2 frises :
- la frise extérieure : dorique
- la frise intérieure : ionique où l'on
constate que des éléments de moulage de la frise des Panathénées sont déjà
en place
Voir une comparaison entre les moulages et la
frise originale |
Côté
Est : la frise a été transférée vers le musée en 1993 et la restauration de ce
côté est maintenant terminée
|
 |
 |
|
Le
côté sud : la restauration est terminée
|
Le côté
nord est entièrement échafaudé et en pleine restauration
|
Pour en savoir plus sur le Parthénon
et sa restauration : voir "LES SECRETS DU PARTHENON"
- L'Érechthéion
:(autres pages sur l'Erechtéion)
La restauration est terminée, elle a été conduite de
1979 à 1987. Les
Cariatides originales ont été transférées au Musée de l'Acropole et remplacées
sur le monument par des copies fidèles. Le monument a été démonté complètement,
les erreurs de positionnement de certains blocs ont été corrigées. Une copie de
la colonne nord-est du monument (enlevée par Elgin et actuellement au British
Museum) ainsi que des parties de l'entablement ont été
repositionnée sur le monument.
  
L'Érechthéion en 2009 : on voit bien les parties
restaurées en blanc
: la frise (à gauche), l'architrave (à droite), les cariatides sont des copies,
les originales sont à l'abri dans les musées.
-
Le temple d'Athéna
Niké :
(autres pages sur le temple d'Athéna Niké)
|

Maquette du temple
d'Athéna Niké |
Ce petit temple a subi de maintes péripéties. Démoli en 1687 par les Turcs, pour
réemployer ses matériaux dans un mur de défense lors du
siège de Morosini, il
fut reconstruit en 1835. En 1936, on dut à nouveau le démonter car son support
menaçait de s'écrouler. En 1998, la frise originale a été transférée au musée.
Depuis l'année 2000, le temple est à nouveau en travaux, il a été démonté
entièrement et il pose de nombreux problèmes. Les fondations, le soubassement *,
les murs et les colonnes sont désormais en place.
Le fronton Est va être
restitué en utilisant une cinquantaine de nouveaux
fragments retrouvés en divers endroits (notamment dans les déblais de la Pinacothèque et
de la maison des arrhéphores). Il est prévu de restaurer la corniche, le fronton est, et trois des six bases d’acrotères
(sommet du fronton est, angles nord-est et sud-ouest) ainsi qu’un certains
nombres de gargouilles en forme de têtes de lions.
La
restauration de la frise avec des copies n'est pas commencée faute d'un accord
scientifique. |
*
le soubassement
de ciment sur lequel avait été reconstruit le monument du Ve siècle a été
remplacé par une grille en métal inoxydable et indéformable sur laquelle ont été
placées les dalles du soubassement.
 |
 |
 |
|
Le temple d'Athéna
Niké en 1981 |
Le temple d'Athéna
Niké en 05/2009 |
Le temple d'Athéna
Niké en 05/2009 |
- La Maison des Arrhéphores
voir
aussi ici
La maison
des Arrhéphores est un bâtiment, identifié par Wilhelm Dörpfeld vers 1920.
Situé près de l'enceinte nord, elle logeait les Arréphores, quatre fillettes qui
avaient pour tâche de préparer les péplos utilisés lors des processions des
Panathénées. L'édifice dessinait au sol un carré 12 mètres de côté. Il
comprenait une chambre unique longée au sud par un portique et d'une volée
d'escaliers.
Le
sol a été entièrement déblayé,
et on y a trouvé plus d'une centaine de fragments architecturaux appartenant au
Parthénon et aux Propylées. Mais ce bâtiment construit au Ve siècle dans un
calcaire de mauvaise qualité est en très mauvais état. En juillet 2006 est prise
la décision d'ensevelir de
nouveau le bâtiment.
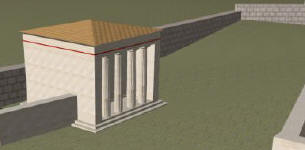 
-
L'installation
d'un réseau de capteurs sismiques
ainsi que celle d'une fibre optique dans les murs, permettra de vérifier
et de surveiller le comportement des bâtiments lors de tremblements de terre.
-
Les murs d’enceinte
Ils ne sont
pas en bon état et
sous surveillance, ils devront être consolidés
-
Le sol du Rocher Sacré
Il
devra être remis en état
et aplani, de
nombreux trous ayant été provoqués par les fouilles et les travaux de
restauration.
L'investissement
humain et
financier
Les travaux, de nature
scientifique, sont le fruit d'une collaboration internationale, notamment avec
la Corée du Sud, l'Italie, le Mexique et la Chine. Plus
de 1.000 architectes et archéologues ont déjà restauré ou remplacé un total de
2350 tonnes de marbre.
Les dépenses des
restaurations de la période 1999-2005 se sont élevées à près de 28,5 millions
d'euros. 86 % ont été couverts par les fonds communautaires. Pour 2005-2006,
l'Europe a accordé à ces projets 10,5 millions d'euros et le trésor grec
2 millions d'euros.
La prévision du budget
initial par L'UNESCO (15 millions de dollars) a donc déjà été largement dépassée
:
Extrait du rapport de 1977 :
"Par lettre circulaire CL/2544 du 2 mars 1977 (Annexe
I), le Directeur général
a adressé aux Etats membres et Membres associés de 1'Unesco le texte de l'appel
en précisant : "à la lumière des consultations que j'ai eues avec les autorités
grecques en 1976, il apparaît nécessaire de réunir en faveur de l'Acropole, une
somme équivalant à 15 millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique, dont une
partie serait fournie par le gouvernement grec et l'autre par des contributions
volontaires que 1'Unesco se chargerait de recueillir auprès des Etats membres ou
Membres associés, d'organismes publics ou privés et de particuliers". Pour
recueillir les fonds nécessaires, le Directeur général invitait les Etats
membres et les Commissions nationales pour 1'Unesco à susciter la création de
comités privés en vue de sensibiliser l'opinion publique aux problèmes de la
sauvegarde de l'Acropole et de susciter des versements à un Fonds international
établi auprès de 1'Unesco."
La
restauration totale de l'Acropole devrait être achevée en 2020.
|