Le musée de Reggio de Calabre (Musée national de la Grande-Grèce ou
Museo Nazionale della Magna Grecia) conserve deux œuvres uniques qui
à elles seules valent la visite de ce musée : deux statues de guerriers qui
comptent parmi les très rares bronzes grecs de grande taille encore
conservés dans leur intégralité, avec l’aurige de Delphes, et le dieu de
l’Artémision.
Toutes les précautions ont été prises pour assurer leur
conservation : structures antisismiques et climatisation parfaites. Les
travaux, qui ont coûté 34 millions d’euros, ont aussi permis de bien
réorganiser le musée qui présente plus de 200 pièces témoignant du passé de
la Calabre, colonisée par les Grecs, les Byzantins ou encore les Arabes.
Pour accéder à la salle qui abrite ces deux trésors, il faut obligatoirement
passer par un sas de décontamination à 21°C, avec un maximum de 20 personnes
dans la salle hyper protégée. Mais bizarrement aucun texte d’explication ne
figure sur les deux guerriers dans la salle d’exposition.
Où ont été
découverts ces deux bronzes ?
Cette découverte, on la doit à un plongeur
amateur, chimiste de profession, Stefano Mariottini. Le 16 août 1972 il part
plonger à 300 mètres de la côte de Riace. A une profondeur de 10 mètres, il
tombe sur un bras, ce qui l’effraie… Il pense qu’il s’agit d’un cadavre. Il
alerte les carabiniers et, grâce à ses indications, une équipe de plongeurs
professionnels va sortir de l’eau deux magnifiques sculptures.
On désigne
aujourd’hui ces bronzes de Riace par deux lettres : le « A », aussi surnommé
« le Jeune » et le « B », dit aussi « le Vieux ».

Le A (1 m 98)
|

Le B (1 m 97) |
Que représentent ces deux bronzes ?
Mesurant
près de 2 mètres et pesant 250 kg chacune, ces statues figurent toutes deux
un guerrier barbu armé, dans la nudité héroïque. Ils sont debout, au repos,
en appui sur la jambe droite (contrapposto*), bras gauche replié, tête
tournée vers la droite.* Le contrapposto, ou hanchement désigne dans les
arts visuels une attitude du corps humain où l'une des deux jambes porte le
poids du corps, l'autre étant laissée libre et légèrement fléchie.
De quand datent ces deux statues ?
Bien que A
et B semblent très proches à première vue, ils présentent des différences
anatomiques qui motivent une datation avec un intervalle d’une génération…
Alors que le torse du guerrier A est encore vertical
malgré son appui sur une seule jambe, celui du guerrier B se courbe, la
ligne des épaules s’opposant à celle des hanches. Cette différence permet
d’affirmer que les deux sculptures ne sont pas contemporaines : le guerrier
A, qui peut être par exemple rapproché du petit Éphèbe de David-Weill (v.
470 av. J.-C., musée du Louvre), est datable de 460 av. J.-C., soit environ
vingt ou trente ans avant le guerrier B (vers 4300 av. J.-C), plus proche
des œuvres de Polyclète (Diadumène, Doryphore)…
Les recherches des sculpteurs du début du Ve siècle
tendent vers la mimésis, l’illusion de la vie, afin d’animer les corps tout
en préservant leur harmonie, comme le montre le guerrier B.
Quelle est la technique utilisée ?
Les deux guerriers sont des témoins de
l’évolution qui a lieu dans les techniques de bronze dès la fin du VIe
siècle av. J.-C. : ils sont réalisés selon la technique de la fonte à la
cire perdue sur négatif, technique qui permet de conserver le modèle et le
moule, et d’obtenir une épaisseur de bronze plus régulière.
La
restauration a révélé un procédé de fabrication inhabituel et audacieux.
Dans la technique de la fonte à cire perdue, la cire est généralement
appliquée dans le moule pris sur le modèle ; on parle de procédé indirect.
Dans le cas des bronzes de Riace, des plaques de cire ont été directement
appliquées sur la statue en terre préalablement cuite qui allait faire
office de noyau. Le sculpteur a pris le risque de perdre son modèle en cas
d’accident de fonte. Par ailleurs, les analyses ont montré que la terre
utilisée n’est pas la même : les deux statues ne sortent donc pas du même
atelier.
Une bandelette retenait la chevelure de A, et un casque venait reposer sur
la calotte que B porte encore. Des matériaux rapportés soulignent avec
raffinement certains détails : le cuivre pour les lèvres, les mamelons et
les cils, l’argent pour les dents. L’ivoire, le calcaire et la pâte de verre
rehaussent encore partiellement les yeux.
Leurs armes ont aujourd’hui disparu mais sont aisément restituables : un
bouclier à leur bras gauche, comme l’indique le brassard qui subsiste, une
lance ou une épée dans la main droite
LE GUERRIER A
La statue A (vers 460 av JC) est dans un état exceptionnel : seules manquent
une mèche de cheveux et les pupilles. C’est un homme jeune, aux cheveux
longs et bouclés ceints d’une bandelette et à la barbe abondamment fournie.
Ses épaules rejetées vers l’arrière donnent l’impression d’un souffle
retenu. Tout en énergie contenue, il semble fixer ou défier un invisible
adversaire, comme pressé d’en découdre. La pondération rompt avec la marche
statique des couroi (statues de jeunes hommes) archaïques. Représenté au
repos, le corps semble pourtant prêt à se mouvoir : il présente un
hanchement, la jambe qui porte le poids du corps étant tendue, l’autre
fléchie. Mais les deux pieds reposent à plat, et la ligne des épaules reste
horizontale.

Le traitement du visage du guerrier A dénote une recherche de polychromie et
un grand raffinement technique. On trouve ainsi pour les lèvres des
incrustations d’un alliage riche en cuivre, donc très rouge et laissé brut
de coulée, sans polissage, tandis que sur les dents est déposée une feuille
d’argent. Les lèvres sont elles-mêmes recouvertes des poils de la moustache
en bronze. Il a donc fallu tout d’abord modeler la tête imberbe en cire, en
ôter la bouche, la fondre puis la réinsérer dans le modèle, avant de
disposer les poils de la moustache et la barbe au-dessus. Plusieurs exemples
de couches, retrouvées à Olympie, montrent que cette pratique d’incrustation
était relativement fréquente.

Les globes oculaires du guerrier A sont en ivoire, recreusé pour y
introduire l’iris (disparu), qui disposait sans doute lui-même d’une cavité
pour la pupille.
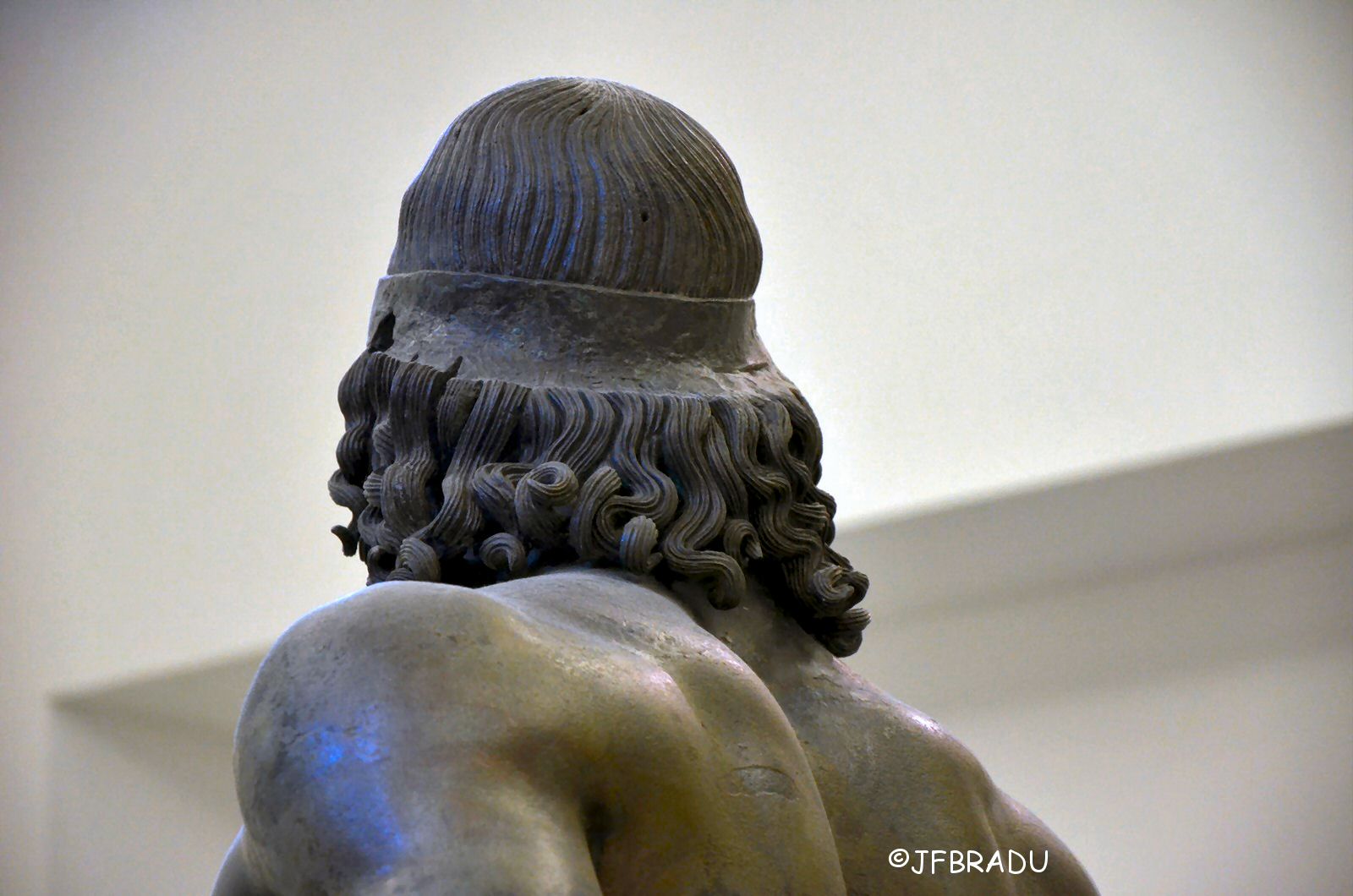
La chevelure, extrêmement plastique et ample, n’est constituée que de mèches
fondues à part (à la cire perdue sur positif) et rapportées par soudure. Il
semble donc que le fondeur, qui devait également être le sculpteur, ait
utilisé un modèle auxiliaire pour prendre l’empreinte du corps sans les
cheveux, puis ait façonné les mèches et les ait ajustées au modèle principal
avant de les découper pour les fondre.

Chez le guerrier A, on note des joints de soudure au niveau du cou, sous les
épaules, aux poignets, à mi-pied et pour les orteils médians1. Le corps en
lui-même a été fondu d’un seul jet.
Comme dans le cas du dieu de
l’Artémision, les soudures, au niveau des poignets, des épaules et de
l’orteil médian ont été réalisées en cuvette. Pour cela, le
bronzier a creusé à la limite de chaque partie à assembler une demi-cuvette
où il a ensuite coulé du bronze. Cette technique, qui augmente la surface de
contact, permet également de disposer avec les cuvettes d’un réservoir à
chaleur et ainsi de mieux chauffer les deux pièces à assembler.
L’armature en fer de la statue dépasse du pied, et servait à la fixer sur sa
base en pierre. Du plomb a été introduit dans la cavité pour la maintenir.
LE GUERRIER B
La statue B (vers 430 av JC) figure un homme apparemment plus mature que A.
Son bras droit a été rapporté dans l’Antiquité : a-t-il été remanié avant
son transport pour former une paire plus convaincante avec A ? Lui aussi est
campé sur sa jambe droite, la jambe gauche au repos. Cependant, si la pose
est semblable, les répercussions du hanchement affectent ici le corps dans
son ensemble. La statue B reprend le système de proportions et de réponses
alternées entre les hanches et les épaules que le sculpteur Polyclète a
défini dans son Canon, un traité théorique illustré par une statue qui n’est
aujourd’hui connue que par des répliques d’époque romaine. Épaules et
hanches se répondent selon des diagonales qui dessinent la lettre grecque χ
(« chi »), d’où le nom de « chiasme polyclétéen » donné à ce rythme du corps
recréé intellectuellement.
Créés pour former un ensemble ou réunis le temps de leur transport vers Rome
?
Le fait que les guerriers de Riace aient été transportés sur le même navire,
sans doute pour un acheteur romain très fortuné, et qu’ils aient finalement
été trouvés ensemble n’est aucunement la preuve qu’ils proviennent du même
endroit, d’un même groupe et encore moins du même atelier. En Grèce, ils
étaient sans doute exposés en plein air dans un espace public, agora ou
sanctuaire, car leur grande taille et l’absence de support les destinent à
être contemplés sous divers points de vue, ce qui est difficile dans un lieu
clos. Ces deux bronzes ont sans aucun doute été créés à la demande d’un
État, d’une ville ou de commanditaires suffisamment riches pour faire
réaliser des statues monumentales en bronze, matériau prestigieux.
Si
l’on en croit les textes antiques, au Ve siècle avant J.-C., plusieurs
groupes monumentaux en bronze représentant des héros semblent avoir été
offerts à de grands sanctuaires, comme Olympie ou Delphes. Les bronzes de
Riace sont-ils les éléments d’une telle offrande ? Un indice peut renforcer
l’hypothèse d’un ex-voto : même si de petits bronzes grecs du Ve siècle
semblent se faire l’écho de ces statues, il n’existe aucune réplique romaine
connue de ces deux œuvres.
Par qui ont été sculptés ces deux géants ?
Aucun élément archéologique ne permet de donner le nom d’un sculpteur ou une
provenance. Depuis la découverte de ces bronzes exceptionnels, les
spécialistes débattent et avancent des hypothèses fondées essentiellement
sur des analyses techniques et stylistiques. Les indéniables qualités
plastiques de ces statues font immédiatement penser à des œuvres conçues par
de grands maîtres. Elles sont ainsi diversement attribuées à Myron,
Hagéladas, Phidias, Alcamène ou Polyclète et ses suiveurs, de célèbres
sculpteurs grecs dont certains ne sont connus que par des textes et des
répliques romaines.
Selon une source, grâce aux analyses de l’argile, on a découvert qu’ils ont
été créés à Argos et Athènes, par les maîtres artistes du Ve siècle avant
notre ère.
D’après les études les plus récents, le bronze A (appelé « le
jeune ») pourrait représenter Tydée, un héros féroce qui provenait de
l’Étolie, fils du dieu Arès. Le bronze B (appelé « le vieux ») pourrait
représenter Amphiaraos qui était un prophète guerrier.
Pourquoi ces guerriers sont-ils représentés nus ?
Dans la Grèce antique, la nudité traduit l’idéal aristocratique du
kaloskagathos, celui qui est « beau et bon ». Porteuse de valeurs nobles et
universelles, cette correspondance entre l'anatomie et la vertu du héros
renvoie à la conception néo-platonicienne liant le beau et le bien. La
nudité exprime le caractère exceptionnel du personnage figuré, ce qui
conduit à représenter ainsi les dieux, les héros et tous ceux qui, comme les
guerriers et les athlètes, aspirent à une héroïsation.
Ainsi, les
athlètes lors des jeux sont nus ou pratiquement nus ; la possession d'un
beau corps est un critère de perfection et une distinction par rapport aux
barbares selon Thucydide.