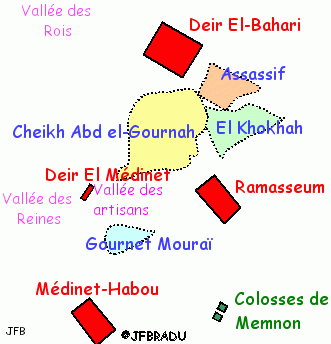|
Naissance
du village. Pour
construire et décorer les tombes des rois, reines et nobles, il fallait une
main d'oeuvre abondante sur place. Sous la XVIIIème dynastie, Thoutmôsis Ier
(1510-1500 av JC) décida de créer un village
pour regrouper tous les artisans nécessaires à l'édification des nécropoles
: carriers, maçons, sculpteurs, dessinateurs, peintres... (une soixantaine
d'hommes, exceptionnellement 120 sous Ramsès IV). Ce village est
situé dans la montagne thébaine, dans la vallée des artisans, à
Deir el-Médineh1, entre la colline de
Gournet Mouraï et Cheikh Abd el-Gournah, son nom égyptien était Set Mâat
("la Place de Vérité"), aujourd'hui on l'appelle aussi le "village des
ouvriers" : c'était le seul lieu d'habitation de vivants sur la rive ouest
du Nil. Ce village connut sa période de prospérité entre les XVIIIème et
XXème dynasties (1560 à 1080 av JC), il était placé sous la protection du
dieu des artisans : Ptah. Le village était relié à la Vallée des Rois par un
sentier traversant la montagne.
Le village des
artisans déménagea à Tell El-Amarna sous le règne d'Akhénaton (1359-1342 av
JC) pour suivre le pharaon dans sa nouvelle capitale. Il revint à Deir
el-Médineh
à l'époque d'Horemheb (1325-1295 av JC). Sous Ramsès XI (1098-1080 av JC),
la communauté quitte définitivement le village pour s'installer dans
l'enceinte du temple de Médinet Habou. Elle fut définitivement dissoute quand les pharaons
abandonnèrent les nécropoles thébaines.
1 Deir el-Médineh : au Nord-Est du village, le temple construit
sous les Ptolémées avait été, croyait-on, transformé en monastère par les coptes, d'où le nom
actuel "Deir el-Médineh" : "monastère de la ville". En
fait, cette dénomination s'applique à la ville de Djémé où les coptes se
sont installés dans le temple de Médinet Habou.
|
 |
|
Un site archéologique unique et exceptionnel.
Historique sommaire des fouilles.
Jusqu'au début du XIXème
siècle, Deir
el-Médineh
enfoui sous les sables (ce qui explique son exceptionnelle conservation)
était inconnu. Les premières fouilles, sous la conduite du consul de
France B. Drovetti, commencent entre 1811 et 1815. Les premiers objets
extraits sont refusés par le Louvre et acquis par le musée de Turin. En
1827, sous Charles X, grâce à l'insistance de Champollion, la deuxième
collection d'objets est acquise par le Louvre. Les fouilles continuent
dans un but lucratif. Ainsi, le diplomate britannique H. Salt vend au
British Museum la fameuse collection qu'il a récupérée. En 1845, avec
l'arrivée du savant allemand Karl Richard Lepsius, l'exploration du site
devient plus scientifique, des tombes sont découvertes et recensées. A
partir de 1858, les Français Auguste Mariette puis
Gaston Maspero
occupent le poste de directeurs du service des antiquités d'Egypte, ils
souhaitent endiguer le trafic d'antiquités. Le 2 février 1866, est
découverte la tombe inviolée de Sennedjem. En 1905, l'italien
Ernesto
Schiaparelli (brillant élève de Maspero) continue les fouilles pour le
musée de Turin, il a la chance de découvrir plusieurs tombes
remarquables (notamment la tombe intacte de l'architecte Khâ dont le
mobilier funéraire se trouve aujourd'hui au musée de Turin). En 1909,
Schiaparelli découvre quelques maisons du village de Deir
el-Médineh,
c'est la première révélation de l'existence d'un village d'artisans et
le début de son exploration. En 1917, la concession des fouilles est
confiée définitivement à l'IFAO (Institut Français d'Archéologie
orientale). Bernard Bruyère, de 1922 à 1951, entreprend une exploration
systématique et rationnelle de la zone archéologique. Il accomplit un
travail immense et exemplaire, en 1928 il découvre la tombe inviolée de Sennefer et de 1949 à 1951, il termine par la fouille du grand
puits2
: des 6000 m3 de terre remontés sans moyen mécanique, plus de 5000
ostraca
inscrits en hiératique et figurés
sont exhumés. Ils permirent de reconstituer les archives documentaires
et littéraires de la communauté des artisans et ainsi de mieux connaître
leur vie quotidienne. Dans son roman "La Pierre de lumière", Bernard
Bruyère a magnifiquement fait revivre la vie des artisans de Deir el
Médineh.
Les ruines de ce village sont d'un intérêt exceptionnel car pour une
fois nous sommes en présence de vestiges qui n'ont pas trait à la vie
des dignitaires mais à celle du peuple égyptien bien moins connu que ses
dirigeants.
2 puits : profond de
plus de 50 m et large de 35 m à l'ouverture, il s'agissait sans doute
d'une tentative de trouver l'eau de la nappe phréatique. L'eau n'ayant
pas été atteinte, les habitants du village utilisèrent ce trou géant
comme décharge. Bernard Bruyère, entre 1949 et 1951, en exhuma une
grande quantité d'ostraca

La maison de l'IFAO |
|